Chaleur invivable en 2100: combien de villes seront touchées ?
D’ici 2100, jusqu’à 217 villes dépasseront 29 °C de température annuelle moyenne, près de 320 millions de personnes exposés.
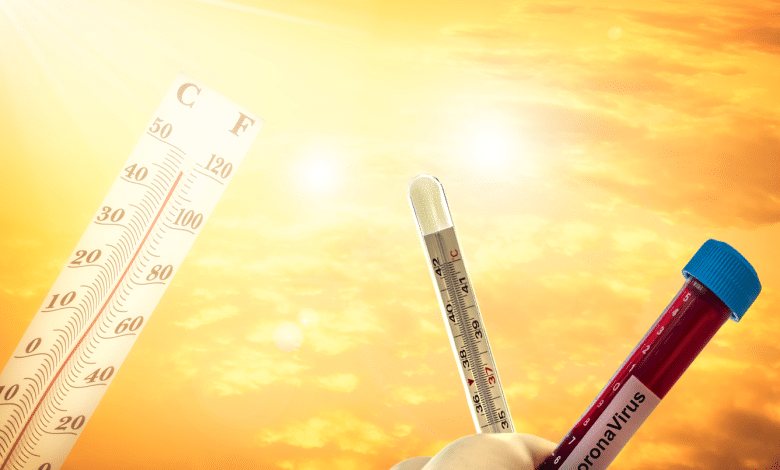
La chaleur extrême gagne nos villes, jour après jour. En bref, environ 217 grandes villes pourraient dépasser une température annuelle moyenne de 29 °C d’ici 2100, un niveau qui met à mal la santé, le travail et les réseaux urbains.
Une étude publiée en 2025 dans Scientific Reports analyse 1 563 villes à l’échelle mondiale. Elle utilise trois trajectoires climatiques, SSP1-2.6, SSP3-7.0 et SSP5-8.5, pour estimer l’ampleur du risque. Les résultats croisent climat, forme urbaine et capacité économique, afin de mesurer la marge d’action réelle.
La température annuelle moyenne, ou MAT, résume la chaleur de fond subie toute l’année. Le seuil de 29 °C signale une sortie du « niche climatique » humain, avec plus de demandes de refroidissement, plus de risques de santé, et moins de productivité. À 27 °C, l’exposition augmente déjà fortement, ce qui change l’échelle du problème.
Les chiffres parlent. Sous SSP3-7.0, des centaines de millions de citadins basculent au‑delà de 29 °C, surtout en Asie et en Afrique. Sous SSP1-2.6, l’exposition baisse nettement, mais ne disparaît pas. L’urgence est claire, l’adaptation aussi, avec des leviers éprouvés, végétation, sols perméables, matériaux réfléchissants et plans d’eau, à ajuster selon les moyens locaux.
Combien de villes et de personnes seront touchées par la chaleur extrême d’ici 2100 ?
Les chiffres se précisent, et ils inquiètent. D’ici 2100, environ 217 grandes villes pourraient dépasser une MAT de 29 °C, un seuil associé à des risques élevés pour la santé, le travail et les services urbains. Sous le scénario SSP3-7.0, plus de 446 millions de personnes vivraient dans des villes au‑delà de ce seuil. À 27 °C, l’exposition explose, avec près de 629 millions de personnes sous SSP5-8.5.
Les hausses ne seront pas uniformes. L’Europe connaîtra les plus fortes augmentations, malgré un climat de départ plus doux. L’Afrique et l’Amérique du Sud partiront de bases déjà chaudes, ce qui place plus vite leurs villes hors du confort thermique.
Les scénarios climatiques expliqués simplement
Les SSP décrivent des futurs possibles. Ils combinent trajectoires socio‑économiques et émissions. Voici les trois utilisés pour les villes.
Soutenez Pressesante.com : Rejoignez notre communauté sur Tipeee
- SSP1-2.6: monde durable, émissions faibles, réchauffement limité. Les hausses restent contenues, mais l’exposition ne disparaît pas.
- SSP3-7.0: croissance démographique élevée, fragmentation, émissions soutenues. C’est le scénario où l’exposition humaine est la plus forte.
- SSP5-8.5: dépendance aux fossiles, fort réchauffement. Les hausses de température sont extrêmes et durables.
Ces trajectoires modulent les hausses régionales de la MAT. Sous SSP5-8.5, l’étude projette des tendances marquées, avec de grands écarts entre continents.
| Région | Hausse de MAT d’ici 2100 | Commentaire clé |
|---|---|---|
| Europe | jusqu’à +4,1 °C | Forte augmentation sur un climat de départ tempéré |
| Amérique du Nord | environ +4,0 °C | Forte hausse en zones urbaines denses |
| Asie | environ +3,8 °C | Grandes mégalopoles très exposées |
| Amérique du Sud | environ +3,2 °C | Hausse modérée, mais bases déjà chaudes |
| Afrique | environ +2,7 °C | Augmentation plus faible, mais chaleur de fond élevée |
Ces valeurs agrégées cachent un point crucial. Les villes africaines et sud‑américaines débutent déjà près des seuils critiques. Une hausse plus faible peut suffire à faire basculer la MAT au‑delà de 29 °C.
Quelques repères utiles pour l’échelle du risque:
- 17 villes dépassaient déjà 29 °C en 2011‑2040.
- 57 villes le feront en 2041‑2070.
- 217 villes y passeront en 2071‑2100, dont une majorité en Asie.
- Sous SSP1-2.6, plus de 59 millions de personnes resteront malgré tout au‑delà de 29 °C.
Pourquoi ces écarts importent‑ils autant pour l’action locale? Parce que le scénario conditionne la hauteur du défi, mais la forme urbaine et la capacité économique fixent la marge d’adaptation. En Europe, la hausse est forte, mais les moyens sont souvent plus élevés. En Afrique, la hausse est plus faible, mais le point de départ est déjà critique, avec des budgets limités. Ce contraste explique l’urgence de mesures ciblées et réalistes.
Où les villes risquent-elles le plus la chaleur invivable ?
Le risque n’est pas uniforme. Il dépend du climat régional, de la densité, et des moyens locaux. Les hausses de MATseront fortes en Europe, mais les seuils critiques seront surtout franchis en Asie et en Afrique, où les villes partent déjà de niveaux élevés.
Trois profils concentrent l’essentiel du risque, avec des réponses adaptées à prévoir:
- Mégapoles déjà chaudes: grandes populations exposées, comme Mumbai ou Chennai, où chaque hausse pèse lourd.
- Villes tempérées mais denses: fortes hausses attendues, comme Madrid, avec un parc bâti massif à rafraîchir.
- Villes chaudes et en croissance: urbanisation rapide, faibles moyens, comme Kaboul, où l’exposition s’emballe.
Deux seuils guident l’analyse. À 27 °C, l’exposition chronique s’étend vite. À 29 °C, la ville sort de la niche thermique humaine. Sous SSP5-8.5, l’Europe chauffe vite, l’Amérique du Nord suit, l’Asie monte moins vite mais reste exposée. L’Afrique et l’Amérique du Sud ajoutent moins de degrés, mais partent haut, ce qui accélère le passage au‑dessus des seuils.
En pratique, les coûts et la capacité d’agir creusent l’écart. Les villes riches peuvent financer le verdissement et des matériaux réfléchissants. Les villes à faible PIB, souvent déjà très chaudes, peinent à déployer ces mesures à grande échelle.
L’impact de la forme urbaine sur la chaleur
La forme urbaine décide en grande partie du stress thermique. Elle peut amplifier la chaleur, ou au contraire l’atténuer, selon la part de surfaces imperméables, la hauteur des bâtiments, et la présence de végétation.
Les villes qui dépassent 29 °C présentent souvent:
- Plus de surfaces imperméables: routes larges, parkings, toits sombres, qui stockent la chaleur.
- Moins de végétation: couvert arboré faible, peu de parcs, peu de sols perméables.
- Des espaces ouverts minéraux: places nues, terrains dégradés, qui chauffent vite au soleil.
Ce schéma est marqué en Afrique et en Asie. Dans ces régions, les villes au‑dessus de 29 °C montrent moins de verts urbains, et davantage de surfaces nues ou imperméables. Le résultat, un pic de chaleur diurne plus fort, et une nuit qui refroidit mal.
Quelques leviers structurants méritent une mise en avant claire:
- Végétation et sols perméables: ils réduisent la température de fond et améliorent le confort.
- Matériaux réfléchissants: toitures claires et revêtements à albédo élevé, pour limiter l’absorption.
- Plans d’eau: forts effets de rafraîchissement, mais coûts élevés en zones arides.
Il est important de noter une limite des données. Les projections climatiques n’intègrent pas tout l’îlot de chaleur urbain. Les quartiers denses peuvent gagner plusieurs degrés en plus, surtout de nuit, ce qui augmente l’écart entre la valeur moyenne et la chaleur ressentie.
En synthèse, la morphologie crée une base thermique, sur laquelle le climat global ajoute des degrés. Plus la ville est minérale et imperméable, plus la hausse de MAT devient pénalisante. À l’inverse, une trame verte et des matériaux réfléchissants abaissent la charge de chaleur, jour après jour.
Comment les villes peuvent-elles s’adapter à la chaleur croissante ?
L’adaptation passe par des mesures éprouvées et bien ciblées. Les priorités sont claires: plus de végétation, plus de sols perméables, des matériaux réfléchissants, et des plans d’eau lorsque l’eau est disponible. Ces leviers refroidissent l’air, abaissent la demande énergétique, et réduisent les risques de santé.
La planification doit suivre la forme urbaine. Les quartiers compacts, minéraux et imperméables chauffent plus fort. Les données de climat ne captent pas tout l’îlot de chaleur urbain, surtout la nuit, ce qui renforce l’urgence locale. Travaillons par zones, à l’échelle des tissus bâtis, en s’appuyant sur les typologies urbaines.
Des choix sobres existent quand les budgets sont limités. Les toitures claires, les ombrières, l’arbre d’alignement, les revêtements perméables et les poches de sols nus végétalisés offrent un gain thermique rapide à coût modéré. Les plans d’eau rafraîchissent bien, mais restent coûteux et délicats en zones arides.
Les défis économiques et les solutions équitables
Les villes chaudes ont souvent les budgets les plus faibles. Le contraste est marqué entre de grandes villes africaines très exposées et les villes européennes plus riches. Le PIB sert de proxy de capacité, mais il ne mesure ni la gouvernance, ni la qualité des institutions, ni la maintenance. Ces facteurs changent la réussite des projets.
Il faut des politiques ciblées et un financement équitable pour déployer les mesures à grande échelle. Les priorités doivent combiner gains rapides et tenues budgétaires, avec des outils simples à exploiter localement.
- Financer l’amont: études, cartographies fines, capteurs de température de rue, et suivi des impacts.
- Miser sur les coûts bas: toitures et façades claires, revêtements à albédo élevé, arbres d’alignement.
- Protéger l’eau: favoriser l’ombre et les sols perméables avant les plans d’eau en zones sèches.
- Programmer par étapes: cibler d’abord les écoles, hôpitaux, arrêts de bus, et axes piétons.
- Assurer l’entretien: budgets dédiés à l’arrosage, la taille, et la réfection des surfaces.
L’aide internationale peut combler l’écart. Elle doit être prévisible, conditionnée aux résultats, et orientée vers le renforcement local.
- Subventions et prêts concessionnels pour verdir rues et toits dans les quartiers chauds.
- Échanges dette‑climat pour libérer des marges budgétaires en faveur du rafraîchissement urbain.
- Subventions à la performance pour la plantation, la survie des arbres, et l’entretien.
- Jumelages de villes pour partager méthodes, achats groupés, et standards de matériaux.
- Outils libres: guides de conception, bibliothèques de matériaux réfléchissants, protocoles de suivi.
Il est important de noter que l’étude suppose une morphologie urbaine statique. Or, l’urbanisation va s’étendre, densifier, et se verticaliser, ce qui peut aggraver la chaleur de fond. Anticipons la croissance: réserves foncières pour parcs et corridors frais, quotas de canopée, seuils de perméabilité par parcelle, et toitures claires par défaut.
En somme, l’équité doit guider l’action. Sans coopération internationale et montée en compétences, les villes les plus chaudes resteront sans moyens. Avec des règles simples, des financements stables, et un suivi sérieux, elles peuvent réduire la chaleur dès aujourd’hui.
En quelques lignes
D’ici 2100, jusqu’à 217 villes dépasseront 29 °C, près de 320 millions exposés. À 27 °C, l’exposition s’élargit vite, la santé et le travail en pâtissent.
Agissons maintenant, adaptons les tissus urbains et réduisons les émissions en même temps. Soutenons des politiques équitables, pour des villes vivables et des vies protégées.
